Au sommaire de la lettre n°39 | novembre-décembre 2024

- Editorial -
La pénurie de temps et de moyens face aux enjeux et à la situation budgétaire fait émerger la notion d'impact
Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT
Notre humanité se débat dans des affres de toute nature : un futur incertain, notamment lié au changement climatique, des modèles sociétaux qui s'affrontent, des stratégies géopolitiques qui organisent le chaos, leurs conséquences sur les politiques d'État et les choix des peuples. La France n'y échappe pas car, au-delà de la crise budgétaire, nos politiques ont déterré la hache de guerre. Les problèmes, au lieu de nous unir pour faire face ensemble, divisent.
Il est tout de même intéressant de noter qu'au sein du monde académique se produit une évolution, presque insidieuse, en relation avec ces contraintes externes. Nos chercheurs académiques ont pour première mission de repousser le front de la connaissance, de produire des concepts qui, à terme, pourront être utilisés par des transformateurs, des intégrateurs, des innovateurs qui sauront en tirer les meilleurs fruits. Le temps n'est cependant pas la donnée d'entrée dans le processus.
Aujourd'hui, le monde académique se trouve confronté à deux pénuries qui bouleversent sa perception de l'usage, et de la temporalité de l'usage, de ses travaux de recherche. Face aux conséquences du changement climatique, les chercheurs ont conscience qu'il leur faut trouver des solutions transférables et efficaces immédiatement. En parallèle, ils ont conscience que la pénurie de moyens les oblige à faire des choix et à viser ce qui a davantage le potentiel d'aboutir. Ainsi nos chercheurs se questionnent sur deux niveaux d'impact pour leurs recherches. C'est relativement nouveau dans la mesure où la recherche a, depuis des décennies pour ne pas dire des siècles, plutôt été guidée par la volonté de savoir que par celle de trouver pour transférer.
Il est intéressant de noter, qu'in fine, cette évolution vers davantage d'impact est assimilée de manière bien plus naturelle par les chercheurs eux-mêmes que si elle avait été demandée par un gouvernement ou une institution. Il y a peu, il eut été impensable, et quelque part à juste titre, de demander à des chercheurs académiques de considérer l'impact temporellement court de leurs travaux. D'aucuns m'accuseront de faire des raccourcis car évidemment la recherche partenariale et la recherche à des fins de transfert vers l'innovation existent depuis longtemps. Mais je voulais partager avec vous cette observation d'une évolution qui constitue, de mon point de vue, une vraie révolution.
Saluons le sens de la responsabilité des chercheurs académiques. Notre futur est largement dépendant de l'impact de leurs travaux. Leur conjonction avec les entreprises, qui les transformeront en solution, constitue un objectif politique majeur. J'invite donc les décideurs politiques à en avoir pleinement conscience.
- L'entretien -
Entretien avec Maxime Trocmé, directeur du déploiement R&D de VINCI
Mehdi Moussaïd
Maxime Trocmé nous parle de la structuration de la recherche dans la communauté d'entreprises que représente le groupe Vinci et nous livre quelques exemples de l'impact de son déploiement.
 Écouter l'entretien :
Écouter l'entretien :
- EUROPE | Décryptage -
Diriger les travaux sur la stratégie européenne de résilience de la ressource en eau - deux points d’attention
Pierre Bitard, ANRT
Alors que des pluies torrentielles s'abattent sur plusieurs régions d'Europe, provocant des effets désastreux, la procédure de nomination en cours de la Commissaire européenne désignée à « l'environnement, à la résilience de la ressource en eau et à l'économie circulaire compétitive » place au premier plan « la stratégie de résilience des ressources en eau ». Focus sur deux enjeux cruciaux de la production d'une telle stratégie.
Entre autres missions, Jessika Roswall, la Commissaire européenne désignée à « l'environnement, à la résilience de la ressource en eau et à l'économie circulaire compétitive » est chargée de « diriger les travaux sur la stratégie européenne de résilience de la ressource en eau » 1, 2, 3, 4.
Pour renforcer la résilience de la ressource en eau, et donc améliorer la préparation face au changement climatique affectant la ressource, il est possible de se référer au guide « Climate change adaptation technologies for water », promu par Climate-ADAPT. Cette plateforme européenne d'adaptation au changement climatique est un partenariat entre la Commission européenne et l'Agence européenne pour l'environnement5. Ce guide présente plus de 100 technologies d'adaptation. Sont répertoriés six grands types de risques climatiques liés à l'eau, auxquels sont associées ces technologies d'adaptation : les risques climatiques inconnus, le manque d'eau, l'excès d'eau, la pollution de l'eau, l'élévation du niveau de la mer et la préparation aux catastrophes. Cette liste constitue une base solide pour la planification et la sélection de technologies adaptées (bien qu'en constante évolution). Nul doute qu'une stratégie européenne de résilience des ressources en eau pourrait trouver dans ce guide une source d'inspiration. A son examen, et sans le réduire à cela, deux ingrédients-clés peuvent être mis en avant : l'implication des parties prenantes locales et l'emploi de méthodologies adaptées pour prioriser les choix technologiques.
L'importance de l'implication des parties prenantes locales
Le guide souligne que l'efficacité des interventions publiques est renforcée par la compréhension approfondie des enjeux locaux associée à l'adhésion des acteurs. Ainsi, la gestion de la qualité de l'eau par des limitations d'usage des terres nécessite la coopération des communautés locales tout au long du continuum de la source à la mer. Seules ces coopérations permettent d'assurer la durabilité des projets et de maximiser leur impact sur le long terme.
Les projections climatiques sont incertaines, qui induisent des impacts variables sur la ressource en eau. Il est donc impératif d'adopter une approche intégrée et flexible de la gestion de l'eau. L'approche qui favorise l'engagement des communautés et des secteurs interconnectés permet de mieux évaluer et anticiper les impacts du changement climatique. Ce même engagement est susceptible d'apporter des bienfaits additionnels comme la protection des habitats et la réduction de la pollution. Les investissements dans les technologies de résilience présentent donc un potentiel environnemental et économique ; une stratégie globale d'adaptation au changement climatique se doit de considérer l'urgence de la mise en œuvre de ces technologies.
Prioriser les technologies d'adaptation climatique, mobiliser l'analyse coûts-avantages
Des outils et méthodes sont présentées qui permettent de sélectionner les solutions les plus pertinentes. Pour une petite communauté rurale, une analyse poussée serait peu nécessaire, une combinaison d'un petit nombre de technologies ciblées pourrait suffire. À l'inverse, pour une grande agglomération urbaine, la priorisation nécessitera davantage de critères d'évaluation et une analyse plus détaillée des options technologiques disponibles. Le choix de l'outil dépend de l'échelle de mise en œuvre (village, ville, région), de la disponibilité d'informations et de la complexité des technologies.
L'analyse coûts-avantages (ACA) est une méthode souvent utilisée pour comparer les coûts et les bénéfices des technologies d'adaptation sur une période donnée. Elle peut être appliquée pour évaluer une seule technologie en détail ou pour comparer plusieurs options.
Les avantages de type « impacts sociaux ou environnementaux indirects » sont plus difficiles à quantifier. L'exemple canonique est celui d'une grande digue qui apporte des avantages mesurables pour l'agriculture ; mais d'autres impacts positifs comme la sécurité énergétique ou l'attractivité demeurent plus compliqués à évaluer.
Les impacts des projets d'infrastructure s'inscrivent souvent dans le long terme. Il est alors nécessaire de recourir à des méthodes de valorisation de bénéfices intangibles, comme la « volonté de payer ». Ces méthodes, bien que perfectibles, permettent d'estimer des bénéfices indirects ou de deuxième ordre. Par exemple, dans le cas de crues provoquées par des pluies torrentielles, les technologies à mobiliser relèvent à la fois des technologies spécifiques aux milieux urbains et aux mesures de protection contre les inondations fluviales. Dans les deux cas, sont concernées des investissements, parfois importants dont les effets vont se produire à moyen et long termes. Ainsi en milieu urbain en va-t-il de l'optimisation des systèmes de drainage urbain ou de la construction d'ouvrages de ruissellement pour stocker temporairement les eaux de pluie ; en matière de protection contre les inondations fluviales, on peut citer les « barrages polyvalents », qui combinent plusieurs fonctions des barrages dans un seul projet d'infrastructure hydroélectrique : le stockage et l'approvisionnement en eau pour l'irrigation, l'industrie et la consommation humaine combinées avec d'autres utilisations telles que la lutte contre les inondations, la production d'électricité, la navigation, le stockage des eaux de ruissellement et la régulation des rejets d'eau. Autant d'avantages susceptibles de justifier les investissements nécessaires.
Références
1Lettre de Mission de Jessika Roswall, Commissaire désignée à l'environnement, à la résilience de l'eau et à une économie circulaire compétitive, 2024, 17 septembre.
https://commission.europa.eu/document/download/10a1fd18-2f1b-4363-828e-bb72851ffce1_en?filename=Mission%20letter%20-%20ROSWALL.pdf
2Programme de travail de la Commission Européenne pour l'année 2024,17 octobre 2023. https://commission.europa.eu/system/files/2023-10/COM_2023_638_1_EN.pdf
3Réponses écrites de Jessika ROSWALL au questionnaire destiné au Commissaire désigné « Environnement, résilience de l'eau et économie circulaire compétitive »,
https://hearings.elections.europa.eu/documents/roswall/roswall_writtenquestionsandanswers_en.pdf, 2024, 28 octobre.
4 Initiative for water resilience (in A European Green Deal), Legislative Train Schedule, European Parliament, 20 octobre 2024.
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/water-resilience/report?sid=8501
5 Climate change adaptation technologies for water. A practitioner's guide to adaptation technologies for increased water sector resilience, 2018, The European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT, UN Climate Technologie Centre & Network,
https://www.ctc-n.org/resources/climate-change-adaptation-technologies-water-practitioner-s-guide-adaptation-technologies
- EUROPE | Actualités -
40 ans du programme-cadre de recherche et innovation : un engagement renouvelé de l’ANRT pour un FP10 ambitieux et l’avenir de la R&I européenne
Irene Creta, ANRT
En septembre l'ANRT a publié son document de positionnement sur le prochain programme-cadre de recherche et d'innovation (PCRI) de l'Union européenne (FP10). Élaboré au sein du groupe de travail ERA, qui réunit 44 organisations françaises engagées dans les projets européens, ce document formule des recommandations visant à renforcer le FP10 et son impact dans un contexte marqué par des défis globaux croissants.
Alors que l'Union européenne arrive à mi-parcours du programme-cadre actuel, Horizon Europe, les discussions sur l'avenir de la politique européenne de R&I s'intensifient. Ce moment décisif invite à une réflexion approfondie : l'évaluation intermédiaire d'Horizon Europe, prévue pour début 2025, mettra en lumière les succès, mais aussi les ajustements nécessaires pour répondre aux défis émergents. Parallèlement, la conception du 10e programme-cadre suscite déjà un vif intérêt et alimente les débats sur le futur.
Dans ce contexte, l'ANRT, grâce au travail de son groupe de travail ERA, a publié un document de positionnement afin de contribuer aux réflexions et d'influencer les décisions européennes en plaidant pour un programme ambitieux, capable de renforcer la R&I en Europe. Cet engagement a été aussi mis en lumière lors de la célébration des 40 ans du PCRI et du service Europe Innovation et Compétitivité (EIC) de l'ANRT le 15 octobre dernier. Un moment clé pour échanger sur les enjeux stratégiques et les perspectives d'avenir des initiatives de R&I en Europe.
Les recommandations de l'ANRT pour le prochain PCRI
Face aux transitions environnementale, numérique et géopolitique, le FP10 doit refléter une ambition renouvelée pour répondre aux attentes des chercheurs, des entreprises, et plus largement des citoyens européens. À travers ses 36 recommandations, l'ANRT aborde plusieurs aspects cruciaux pour faire de ce futur programme-cadre un levier de transformation pour l'Europe :
- un programme ambitieux : il faudra assurer un PCRI fort, disposant d'un budget conséquent et à la hauteur pour relever les défis mondiaux et garantir la compétitivité de l'Europe
- un programme complet et équilibré : le FP10 doit proposer des opportunités diversifiées pour la R&I, couvrant l'ensemble des niveaux de TRL, les projets de petite et grande envergure, les mono-bénéficiaires et les collaboratifs, les approches top down et bottom up, ainsi que la collaboration interdisciplinaire et intersectorielle
- stabilité et simplification : pour encourager la participation, il est impératif de garantir continuité et stabilité et de mettre en œuvre les développements nécessaires pour améliorer la clarté et l'accessibilité, éviter les lourdeurs administratives et promouvoir la transparence et simplification. Cela concerne d'abord la structure du programme, dont les instruments de financement doivent être rationalisés pour éviter les chevauchements et simplifier les procédures. Ensuite, cela concerne les règles de financement, qui doivent être encore simplifiées, en permettant aussi en alignement plus forte avec les pratiques internes des bénéficiaires, pour garantir un accès plus large et de réduire les erreurs.
- flexibilité accrue : le programme devra s'adapter rapidement aux priorités émergentes pour rester pertinent face aux évolutions rapides des contextes globaux
- ouverture internationale : maintenir une approche équilibrée avec les pays tiers et établir des partenariats stratégiques responsables est crucial pour la compétitivité européenne
- synergies renforcées : faciliter toutes les synergies possibles entre les programmes de l'UE et les connexions entre les actions du programme cadre afin de soutenir la transition de la recherche vers l'innovation
Retour sur l'événement des 40 ans du PCRI et du Service EIC de l'ANRT
Le 15 octobre dernier a marqué un moment clé en réunissant des acteurs majeurs du paysage européen de la recherche et de l'innovation ainsi que des institutions. Cet événement a permis de réaffirmer l'importance d'un PCRI solide, véritable moteur de la recherche collaborative. Lors de la table ronde présidée par Robert Jan Smits (président de l'Université de technologie d'Eindhoven), les participants ont mis en lumière la nécessité de favoriser une recherche audacieuse et risquée, soutenue par des financements ciblés et adaptés aux enjeux actuels, l'importance de garantir aux laboratoires académiques des moyens solides et assurer un transfert efficace des connaissances vers les entreprises. Avec 140 participants, cet événement a été salué comme un succès, permettant de dégager des perspectives déterminantes pour l'avenir du PCRI, tout en réaffirmant l'engagement de l'ANRT et de ses membres à promouvoir une politique européenne de recherche et d'innovation ambitieuse et alignée sur les priorités stratégiques.
Pour en savoir plus
Le document de positionnement complet est disponible sur le site de l'ANRT
- Focus -
Explorer la Lune dans un monde en pleine transition climatique
Alban Guyomarc'h, ANRT
À l'occasion de la parution de la dernière note du groupe de travail Objectif Lune « L'empreinte environnementale des activités spatiales et de l'exploration de la Lune », Clarisse Angelier et Alban Guyomarc'h reviennent sur ses principaux enseignements.
À la croisée des défis climatiques et spatiaux
Dans un monde qui se réchauffe climatiquement et politiquement, le grand public s'interroge légitimement sur l'intérêt des grands programmes d'exploration spatiale. Certains participants aux nouvelles ambitions spatiales, publics comme privés, ont entendu cet appel – notamment les agences spatiales, telles l'ESA ou le CNES, qui ont initié une réflexion sur l'empreinte environnementale des activités spatiales en général, et de l'exploration en particulier.
C'est aussi le cas de certains industriels du secteur spatial, qui amorcent une réflexion d'ingénieur et d'acteur sur la voie d'un spatial plus durable. Alors que le changement climatique façonne l'agenda international, le secteur spatial est lui aussi confronté à un impératif de transformation. Décarbonation, atténuation de l'impact, amélioration des cycles de vie des objets spatiaux, réduction des débris : les enjeux techniques et politiques sont nombreux
Mieux comprendre et agir sur l'impact environnemental
Pour réduire l'empreinte des activités spatiales, deux axes de travail s'imposent :
- un axe technique : l'atténuation de l'empreinte environnementale des activités spatiales est une question de technologie, un problème d'ingénieur. Il faut innover sur des aspects tels que la durabilité des systèmes, l'utilisation de carburants moins polluants, et la gestion des débris spatiaux. Le développement d'analyses de cycle de vie (ACV) spécifiques au spatial (un secteur encore marqué par l'inédit et qui ne se met que progressivement à la production en série), l'élaboration d'indices permettant de mesurer la durabilité des activités spatiales (SSR, etc.) ainsi que la mise en place de politiques de décarbonation ciblées figurent parmi les priorités.
- un axe politique : car à côté de la réflexion menée dans le domaine de l'ingénierie, la question porte aussi sur nos modèles d'exploitation et d'exploration de l'espace à l'heure d'une intensification majeure de l'activité des secteurs spatiaux (augmentation du nombre de lancements, annonces toujours plus importantes de méga-constellations, etc.). Une réflexion européenne sur le questionnement des usages dans l'espace devrait mener à ranimer une expression ancienne de l'Europe spatiale, celle de l'espace utile : c'est-à-dire l'investissement public sur des programmes et projets spatiaux conjuguant autonomie stratégique européenne et utilité démontrée en réponse à des besoins stratégiques préalablement définis. Une voie intermédiaire donc, entre d'un côté le modèle New Space à l'américaine, et de l'autre, un modèle national-planifié à la chinoise ou à l'indienne.
La Lune : ajuster l'échelle des ambitions aux exigences du temps
Tout comme les programmes d'utilisation de l'espace orbitale, les programmes d'exploration spatiale sont concernés par ce questionnement environnemental. Depuis l'annonce du retour des ambitions lunaires il y a moins d'une décennie, une réflexion collective anime les secteurs publics et privés, spatiaux et non spatiaux, sur l'intérêt qu'aurait l'Europe à s'engager plus activement vers l'exploration de la Lune. L'ANRT a été et demeure l'un des acteurs de cette réflexion, et ce, grâce à l'investissement de ses membres au sein du groupe de travail Objectif Lune.
L'un des volets de cette réflexion, un volet majeur, doit confronter cette ambition d'exploration aux exigences environnementales et de responsabilité du siècle : c'est la condition sine qua non de la légitimité sociale et de la soutenabilité climatique des programmes lunaires. L'enjeu n'est pas de chercher à dessiner une ambition lunaire (faussement) verte – mais une ambition lunaire responsable face aux exigences du temps, c'est-à-dire à l'échelle adéquate et permise ainsi qu'aux objectifs dûment justifiés. Une ambition qui prend acte du choix stratégique de nos partenaires internationaux d'ériger la Lune en nouveau terrain de l'exploration spatiale, avec le développement de compétences et savoir-faire inédits et stratégiques.
Dans ce contexte, l'Europe devrait se focaliser sur le développement d'une ambition lunaire autonome, robotisée, scientifique et frugale. Les missions lunaires récentes - hors Artémis - démontrent la possibilité de missions peu coûteuses d'exploration. Mobilisant son savoir-faire existant au service de compétences stratégiques à développer pour l'exploration spatiale, l'Europe pourrait s'engager dans les champs de la cartographie, de l'analyse géologique et de l'observation de la Lune. Ayant développé des compétences clés, notre continent pourrait ensuite jouer de son réseau intense de coopération, mais aussi des liens de coopération à tisser avec d'autres puissances spatiales émergentes ; et ce afin de s'ouvrir service contre service vers d'autres compétences spatiales en coopération, dont le vol habité.
Les ambitions spatiales européennes doivent s'ajuster aux priorités d'une planète en mutation : la priorisation des investissements publics sur la transition environnementale va nécessairement peser sur les budgets alloués au secteur spatial en général et à l'exploration spatiale en particulier. La question n'est pas d'abandonner l'exploration, mais de mieux en définir les contours. Investir dans des projets centrés sur la science et la coopération internationale pourrait non seulement renforcer la légitimité sociale des programmes lunaires, mais aussi en faire des vecteurs de pacification globale.
L'Europe a l'opportunité de tracer une voie singulière en matière d'exploration spatiale : une voie plus conforme aux exigences du temps. Grâce à ses ingénieurs, ses valeurs et son talent pour la coopération, elle peut développer un modèle équilibré : innovant, inclusif et adapté aux défis du XXIe siècle. C'est en assumant cette ambition lucide et partagée que l'Europe pourra explorer la Lune tout en respectant les limites de la Terre.
* Note "L'empreinte environnementale des activités spatiales et lunaires" et Tribune parue dans Le Monde en ligne du 17 novembre 2024

- Point de vue -
L’achat public, l’outil clé de la politique en faveur de la demande d’innovation
Pierre Bitard, ANRT
Le rapport Heitor, qui évalue à mi-parcours l'avancée d'Horizon Europe, clôt, avec les rapports Letta et Draghi, une séquence qui fait de l'achat public d'innovation un levier indispensable de la politique industrielle et de l'innovation.
La recommandation du rapport Heitor 1 est claire et simple : « Libérez la puissance de la demande en élaborant un programme d'achat d'innovation pour stimuler une montée en puissance plus rapide de l'industrie ». Cette approche, loin de constituer une rupture, est bien connue et anime, depuis les années 2005, une communauté de recherche et de think-tanks, dont ceux proches de la Commission Européenne et l'OCDE.
Ces travaux démontrent la puissance des effets de la demande publique d'innovation sur l'innovation des entreprises. Avec des bénéfices économiques plus larges, et un potentiel de transformation élevé. L'argument économique souligne la conjonction d'intérêts des parties prenantes. D'une part, les pouvoirs publics peuvent et doivent favoriser l'émergence de produits et de services innovants sur le marché, grâce au pouvoir structurant de la commande publique. A l'échelle européenne, ils formulent des règles d'action en accord avec leurs priorités stratégiques (transformation écologique en particulier). D'autre part, les entreprises entendent se développer en vendant leurs produits différenciés grâce à l'innovation, et non en bénéficiant d'incitations publiques. Bien que les achats publics représentent près de 14 % du PIB de l'UE, exploiter pleinement le potentiel des marchés publics reste un projet à promouvoir.
D'où la dixième recommandation d'Heitor qui met en avant la nécessité de réformer les pratiques d'achat public pour mieux aligner les investissements publics sur les priorités européennes.
Pour le lancement d'un programme stratégique d'achats d'innovation
L'expérience (soutenue par la théorie) dicte la conduite à tenir. Soulignons ici deux attributs clés du design de cette politique. En premier lieu, il convient de caler la politique d'innovation via l'achat public sur l'atteinte d'objectifs stratégiques de l'Union tels la réalisation de la neutralité carbone, le renforcement des capacités de sécurité et de défense de l'Europe et la fourniture de services publics de qualité (santé, éducation, etc.). De plus, au lieu d'une prescription de solutions et de technologies, les appels d'offres publics ouverts doivent cibler les besoins et les fonctions. Ces deux conditions sont nécessaires pour contribuer à la création de marchés pour des solutions pertinentes et souhaitables pour la société.
A titre d'exemple, un achat public d'innovation de la CE, via un appel d'offres aurait pour objectif de « décarboner les infrastructures critiques » - tels les aéroports ou les ports, mais sans indiquer de type de solution requise. Un tel marché public agirait comme déclencheur de la demande de solutions innovantes, en « dérisquant » l'investissement dans de nouveaux domaines de recherche et d'innovation. En effet, il est établi que le principal frein à l'installation de cette pratique d'achat d'innovation est l'aversion au risque des acheteurs publics. Ces derniers considèrent trop risqué de s'engager en mobilisant leurs budgets d'achat habituels. Et trouvent compliqué d'utiliser les produits financiers existants (les prêts bancaires, par exemple) pour les marchés publics d'innovation.
Dérisquer les investissements des acheteurs publics d'innovation : où trouver l'argent ?
Ce qui est fait en la matière depuis plusieurs années et qui consiste à favoriser le cofinancement public-privé s'avère notoirement insuffisant. C'est pourquoi la recommandation 10 promeut l'usage des « nouvelles ressources propres » européennes pour soutenir les acheteurs publics. Au-delà de difficultés possibles de mise en œuvre, on pense ici au fonds d'innovation associé au système d'échange de quotas d'émission (ETS), géré par la DG CLIMA. Il y aurait aussi le programme Next Generation EU, géré par la Facilité pour la reprise et la résilience (RRF), et les Plans nationaux pour la reprise et la résilience (RRP). Ces plans devraient être étroitement articulés avec Horizon Europe, le programme-cadre européen. Un effort de gouvernance coordonnée s'avère ici indispensable.
Références
1 Align, act, accelerate. Research, technology and innovation to boost European competitiveness, 2024, European Commission, Septembre.
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2f9fc221-86bb-11ef-a67d-01aa75ed71a1/language-en
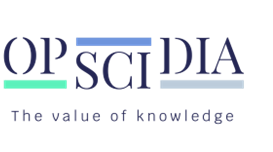
- L'invité -
Les limites de ChatGPT en science et l'utilisation réfléchie de l'IA générative
Sylvain Massip, CEO & co-fondateur d'Opscidia
Dans un contexte où l'intelligence artificielle (IA) est omniprésente, il est essentiel de démystifier ses capacités et ses limites, surtout dans le domaine scientifique. Cet article explore les défis et opportunités qu'offre l'IA générative pour les professionnels, avec un focus particulier sur les outils comme ChatGPT et la solution Opscidia. En allant au-delà des simples promesses technologiques, il s'agit ici de montrer comment ces IA peuvent devenir de véritables alliées des scientifiques... à condition de savoir bien les dompter ! Que vous soyez curieux ou sceptique, ce sujet nous pousse à réfléchir : l'IA peut-elle vraiment remplacer l'humain dans la quête de précision scientifique ?
 1/ Pourquoi les LLMs* ne sont pas bons en science ?
1/ Pourquoi les LLMs* ne sont pas bons en science ?
ChatGPT, bien qu'impressionnant par sa capacité à générer du texte cohérent, présente des limitations significatives en matière de précision scientifique. L'une des principales raisons est que ChatGPT est formé sur des données textuelles disponibles publiquement, qui peuvent inclure des informations obsolètes ou incorrectes. De plus, l'IA peut "halluciner" des faits, c'est-à-dire générer des informations fausses ou inventées, ce qui est particulièrement problématique dans un contexte scientifique où la rigueur et la véracité sont essentielles.
En outre, ChatGPT manque de compréhension contextuelle profonde. Il peut fournir des réponses superficielles ou incomplètes à des questions complexes, car il ne possède pas la capacité de raisonner ou de vérifier les informations comme le ferait un expert humain. Cette limitation est exacerbée par le fait que l'IA ne peut pas accéder à des bases de données scientifiques spécialisées ou à des publications récentes, ce qui limite sa pertinence pour les chercheurs.
Enfin, l'IA générative est sujette aux biais présents dans les données d'entraînement. Ces biais peuvent se manifester sous forme de préjugés raciaux, de genre ou autres, ce qui peut fausser les résultats et les analyses. Pour les scientifiques, ces biais représentent un obstacle majeur à l'utilisation de ChatGPT comme outil fiable pour la recherche et la communication scientifique.
2 / Comment dompter l'IA générative pour outiller les scientifiques ? Et quelles applications ?
Pour tirer le meilleur parti de l'IA générative, comme ChatGPT, dans le domaine scientifique, il est crucial de comprendre et de contourner ses limitations. Bien que l'IA puisse générer des textes cohérents, elle peut également produire des informations inexactes ou obsolètes, en raison de la nature de ses données d'entraînement. Une approche stratégique consiste à utiliser l'IA pour des tâches simples et répétitives, comme le résumé d'articles ou la génération de brouillons initiaux de documents, tout en s'assurant que des experts humains vérifient et corrigent les informations pour garantir la précision scientifique. Ainsi, l'IA peut être un outil complémentaire puissant, permettant aux scientifiques de se concentrer sur des tâches plus complexes nécessitant une expertise approfondie.
Un autre aspect essentiel pour dompter l'IA générative est de gérer et de minimiser les biais présents dans les données d'entraînement. Les biais peuvent fausser les analyses et mener à des conclusions erronées, ce qui est particulièrement préjudiciable dans la recherche scientifique. Pour atténuer ces risques, il est nécessaire de développer des protocoles robustes de vérification et de validation des réponses générées par l'IA. Cela peut inclure l'intégration de bases de données spécialisées et actualisées, ainsi que l'utilisation de modèles d'IA capables de citer leurs sources, augmentant ainsi la transparence et la fiabilité des informations fournies.
Enfin, l'utilisation de l'IA générative dans des contextes scientifiques exige une compréhension précise du contexte et des termes techniques. ChatGPT, par exemple, peut mal interpréter des concepts complexes, ce qui peut entraîner des réponses incorrectes. Pour surmonter cette limitation, les scientifiques doivent utiliser l'IA en complément de leur expertise, en vérifiant systématiquement les informations générées avant de les intégrer dans leurs travaux. De plus, des formations sur l'utilisation et les limites de l'IA peuvent aider les chercheurs à exploiter ces outils de manière plus efficace et sécurisée.
3/ Faire adopter l'IA par les scientifiques : un projet de transformation digitale !
L'adoption des technologies d'intelligence artificielle par la communauté scientifique reste un défi de taille, nécessitant une véritable transformation digitale.
Chez Opscidia, nous avons compris que l'intégration réussie de l'IA dans les pratiques de recherche ne se résument pas à fournir des solutions techniques. Il s'agit d'un réel projet de transformation digitale. Notre approche consiste à accompagner les scientifiques tout au long de ce parcours, en les aidant à changer leurs habitudes et à tirer le meilleur parti de ces nouvelles technologies.
Tout d'abord, nous mettons l'accent sur la formation. Nos équipes délivrent des formations sur mesure pour permettre aux chercheurs de comprendre les principes sous-jacents de l'IA et d'en maîtriser les outils de manière efficace.
Ensuite, nous accompagnons nos clients dans la durée, en assurant un support technique continu et en recueillant leurs retours d'expérience. Cela nous permet d'améliorer constamment nos solutions et de répondre aux nouveaux défis qui émergent au fur et à mesure de l'adoption de ces technologies.
Faire adopter l'IA par les scientifiques n'est pas seulement une question technique, mais un véritable projet de transformation digitale.
4/ Comment répondre aux défis des scientifiques ?
Dans un contexte d'évolution rapide des besoins et des exigences de la communauté scientifique, Opscidia se distingue par l'intégration de l'IA générative dans ses solutions. Cette approche permet de fournir des réponses précises et adaptées aux attentes croissantes des chercheurs et professionnels du domaine. Un exemple concret de cette innovation est l'outil Report Assistant.
Traçabilité des sources et limitation des hallucinations
Premièrement, Opscidia veille à la fiabilité de l'information générée par l'IA grâce à la traçabilité des sources. L'outil Report Assistant assure que chaque donnée incluse dans un rapport est appuyée par des références vérifiables, minimisant ainsi les risques d'hallucinations de l'IA. Cette traçabilité permet aux chercheurs de valider facilement les informations et de maintenir un haut niveau de crédibilité scientifique.
Travail collaboratif et génération du plan
Ensuite, Report Assistant facilite le travail collaboratif entre les chercheurs et l'IA, notamment lors de la génération du plan du rapport. L'IA formule une proposition de plan initiale que les utilisateurs peuvent ajuster, personnaliser et enrichir avec leur expertise. Cette collaboration interactive permet de structurer efficacement le contenu, en définissant les sections principales et les points clés à aborder. En conclusion, le gain de temps ainsi réalisé permet aux chercheurs de se concentrer davantage sur l'analyse et l'interprétation des résultats.
Gain de temps et efficacité
Enfin, l'utilisation de l'IA générative avec Report Assistant se traduit par un gain de temps considérable. La rapidité avec laquelle les rapports sont produits permet aux scientifiques de respecter des délais serrés sans compromettre la qualité du contenu. Cette efficacité accrue libère du temps pour d'autres activités de recherche et d'innovation, augmentant ainsi la productivité globale des équipes scientifiques.
En conclusion, Opscidia maîtrise l'IA générative pour répondre aux exigences des scientifiques à travers des fonctionnalités avancées comme Report Assistant. En assurant la traçabilité des sources, en facilitant la collaboration pour la génération du plan, et en améliorant l'efficacité du processus de production, Opscidia permet aux scientifiques de se concentrer sur l'essentiel : l'innovation et l'avancement des connaissances scientifiques.
5/ Des cas d'usages
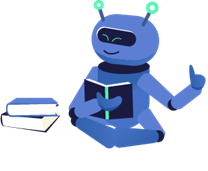 Cas d'usage 1 : Synthèse d'articles scientifiques
Cas d'usage 1 : Synthèse d'articles scientifiques
En tant qu'expert en technologie d'affichage pour écrans d'ordinateurs portables et téléviseurs, j'ai entrepris une étude sur l'utilisation d'une technologie spécifique pour un produit destiné à un client. Pour ce faire, j'ai réalisé plusieurs sous-projets sur la plateforme Opscidia, chacun correspondant à une technologie différente.
Défi : synthétiser des articles scientifiques longs et techniques pour les présenter au client.
Solution :
1. Sélection des articles : J'ai choisi les articles les plus pertinents sur chaque technologie et les ai intégrés dans un rapport.
2. Utilisation de l'outil Report Assistant :
- analyse du titre - comprend l'objet principal du rapport.
- examen des documents - capte les informations nécessaires.
- proposition de plan - l'utilisateur peut adapter ce plan avant la rédaction.
- rédaction du rapport - utilise les articles, les données fournies et le plan validé pour générer le rapport final.
Bénéfice : gain de temps considérable et production d'un rapport clair et concis adapté aux besoins du client.
Cas d'usage 2 : Recherche d'informations spécifiques
Missionné par un client pour se renseigner sur la réglementation concernant le recyclage des batteries de téléphones portables et d'appareils mobiles, j'ai rassemblé un corpus de documents traitant de ce sujet.
Défi : trouver des informations spécifiques dans un document de plus de 70 pages.
Solution :
1. Identification du document pertinent : utilisation de la plateforme pour repérer le document le plus probable contenant les réponses.
2. Utilisation de l'outil de question answering :
- pose de questions en langage naturel - permet de surligner les informations pertinentes.
- sélection de réponses - propose une liste de réponses avec un pourcentage de probabilité de correspondance à la question.
Bénéfice : accès rapide et précis aux informations nécessaires sans avoir à lire l'intégralité du document.
6/ Conclusion
La rencontre entre l'intelligence artificielle et la recherche scientifique ouvre des perspectives intéressantes, mais apporte aussi des défis importants. Bien que des outils comme ChatGPT montrent des limitations en termes de précision et de compréhension contextuelle, leur potentiel pour simplifier des tâches répétitives et générer des documents initiaux ne doit pas être sous-estimé. Les scientifiques peuvent contourner les limites de ces IA en les utilisant comme des assistants complémentaires, vérifiant et validant toujours les informations produites. De plus, la gestion proactive des biais dans les données et l'amélioration continue des protocoles de vérification sont essentiels pour renforcer la fiabilité de ces technologies. Opscidia illustre parfaitement comment une intégration judicieuse de l'IA générative peut transformer les pratiques de recherche, en offrant des outils comme Report Assistant qui facilitent la synthèse d'articles et la recherche d'informations spécifiques. En somme, la clé réside dans une adoption éclairée et progressive de l'IA, soutenue par une formation adéquate et un support continu, permettant aux scientifiques de se concentrer sur l'innovation et l'avancement des connaissances.
A propos de l'auteur
Sylvain Massip, CEO & co-fondateur d'Opscidia, est titulaire d'un doctorat en physique de l'Université de Cambridge et cumule dix ans d'expérience entre recherche scientifique et industrie. Passionné par l'accessibilité de l'information scientifique, il a co-créé Opscidia pour fournir aux chercheurs et aux professionnels des outils basés sur l'intelligence artificielle qui facilitent l'analyse, la synthèse et l'extraction de données complexes. Sous sa direction, Opscidia s'engage à démocratiser la science ouverte et à accompagner les acteurs de l'innovation dans leur quête de rigueur et d'efficacité.
* Large Language Model
- Agenda -
_
ReSCI | Communs numériques et intérêt général
Présidents - Arnaud
Levy, cofondateur, Noesya et Sébastien Schulz, enseignant en sociologie,
animateur du groupe « politiques des communs numériques » (CIS-CNRS) et
initiateur du « Collectif pour une société ».
mer 27/11/2024 - 15:00 - mer 27/11/2024 - 18:00
ANRT et Visioconférence
Questions réponses sur le dispositif Cifre | Etudiants
ven 29/11/2024 - 14:00 - ven 29/11/2024 - 15:00
Distanciel
Petit déjeuner | Anthony Briant & Jérôme Lesueur, Ecole des Ponts ParisTech
jeu 12/12/2024 - 08:30 - jeu 12/12/2024 - 10:00
ANRT et en visioconférence
Webinaire de présentation du dispositif Cifre | Etudiants
BIENTÔT OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
jeu 12/12/2024 - 11:00 - jeu 12/12/2024 - 12:15
Distanciel
Questions réponses sur le dispositif Cifre | Employeurs et institutionnels
INSCRIPTION
ven 13/12/2024 - 14:00 - ven 13/12/2024 - 15:00
Distanciel
Petit déjeuner | Elodie Du Fornel, Engie - Rapport Technologies Durables Emergentes 2024
jeu 23/01/2025 - 08:30 - jeu 23/01/2025 - 10:00
ANRT et en visioconférence